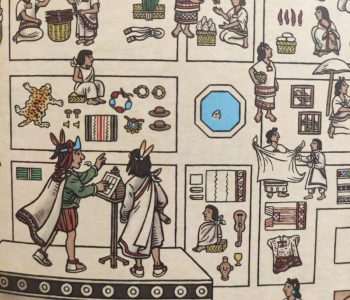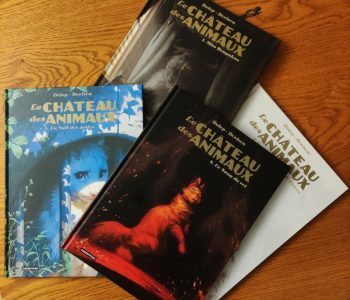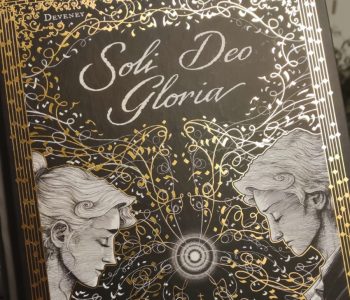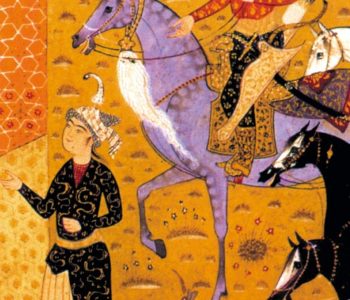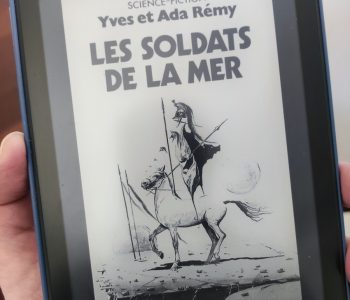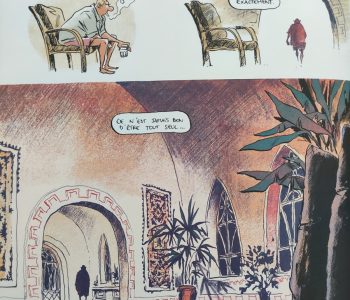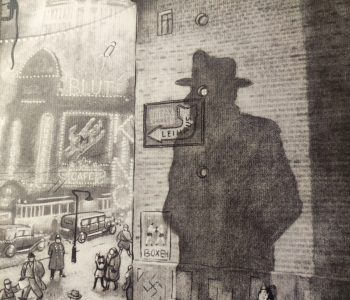lecture
lecture
La Terre Verte d’Ayroles, Tanquerelle et Merlet
Une œuvre avec des noms aussi prestigieux au scénario et au dessin : à coup sûr, c’est une affaire que l’on va suivre ! Cette aventure dans le grand froid du Groenland offre un récit fouillé quoique classique. Qualité de l’écriture et des planches sont bien au rendez-vous. Une bonne lecture, à laquelle il manque néanmoins le grain de folie qui en ferait un incontournable du 9è art.
J’ai terminé hier soir la lecture de la Terre Verte de MM. Ayroles au scénario et Hervé Tanquerelle au dessin, ainsi qu’Isabelle Merlet à la coloration. Un incipit, citation tirée du Roi Lear – “C’est le malheur des temps que les fous guident les aveugles” (Acte IV, scène 1, le Roi Lear, Shakespeare), et le remerciement du scénariste en conclusion de l’œuvre nous indiquent que celle-ci est fortement marquée de l’influence de Shakespeare. Un peu à la manière de ce que fait le Meilleur des Mondes de Huxley.

Alors que l’Eglise est absente du Groenland depuis un siècle, Rome envoie Mgr Matthias comme nouvel administrateur du diocèse de ce pays du Grand Nord. Au début du livre, nous rencontrons le prélat naviguant vers la Terre Verte, accompagné pour la sécurité de son voyage par Richard, soldat expérimenté, bossu, malformé, noireau, la gueule de travers, redoutable à l’épée et dans le verbe. Un choc des cultures entre d’une part le monde traditionnel romain de l’évêque et d’autre part une population locale, restée fidèle à sa foi chrétienne en même temps que singularisée par son implantation locale, sert l’opportunisme politique de Richard. Le lecteur découvre le parcours de ce dernier, son passé, ses échecs, motivations d’une quête acharnée de pouvoir absolu et sans vergogne.
Passions humaines déchaînées, manipulation du groupe aux fins personnelles, omniprésence de la mort : la Terre Verte rappelle par certains aspects les thèmes abordés dans 1629. Chronique du pouvoir politique et de la tragédie qu’enclenche sa recherche à tout prix. Le travail d’écriture peut ici être rapproché des Indes Fourbes. Celui-ci imaginait une suite à un roman picaresque du XVIIè siècle. Celui-là explore un récit alternatif au Richard III du dramaturge anglais. L’auteur y est habitué (cf. le travail sur de Capes et de Crocs) : la mise en scène des références culturelles, il sait faire ! Et dans le passage de la chaleur du Nouveau Monde aux glaces du Groenland, le lecteur troque le truculent pour le sérieux.
C’est bien ficelé, beau (quel trait de Tanquerelle, dont je n’avais précédemment lu que le Dernier Atlas !), écrit de façon admirable (comme sait le faire Ayroles). On tient là à n’en pas douter une très belle BD. Mais je dois bien avouer que j’ai passé la traversée de ce volume à me demander quand l’œuvre allait devenir excellente. Peut-être trop attisé par l’attente et ce qui s’en est dit.
J’insiste, c’est une bonne BD ! Simplement, il m’a manqué ce grain de folie que l’on trouve dans les Indes Fourbes et qui m’avait alors conduit à penser que je lisais un truc autre, absolument génial. Ceci étant dit, j’ai bien envie de relire le volume en m’attardant à chaque planche pour tenter d’y déceller chaque clin d’œil au maître Shakespeare.